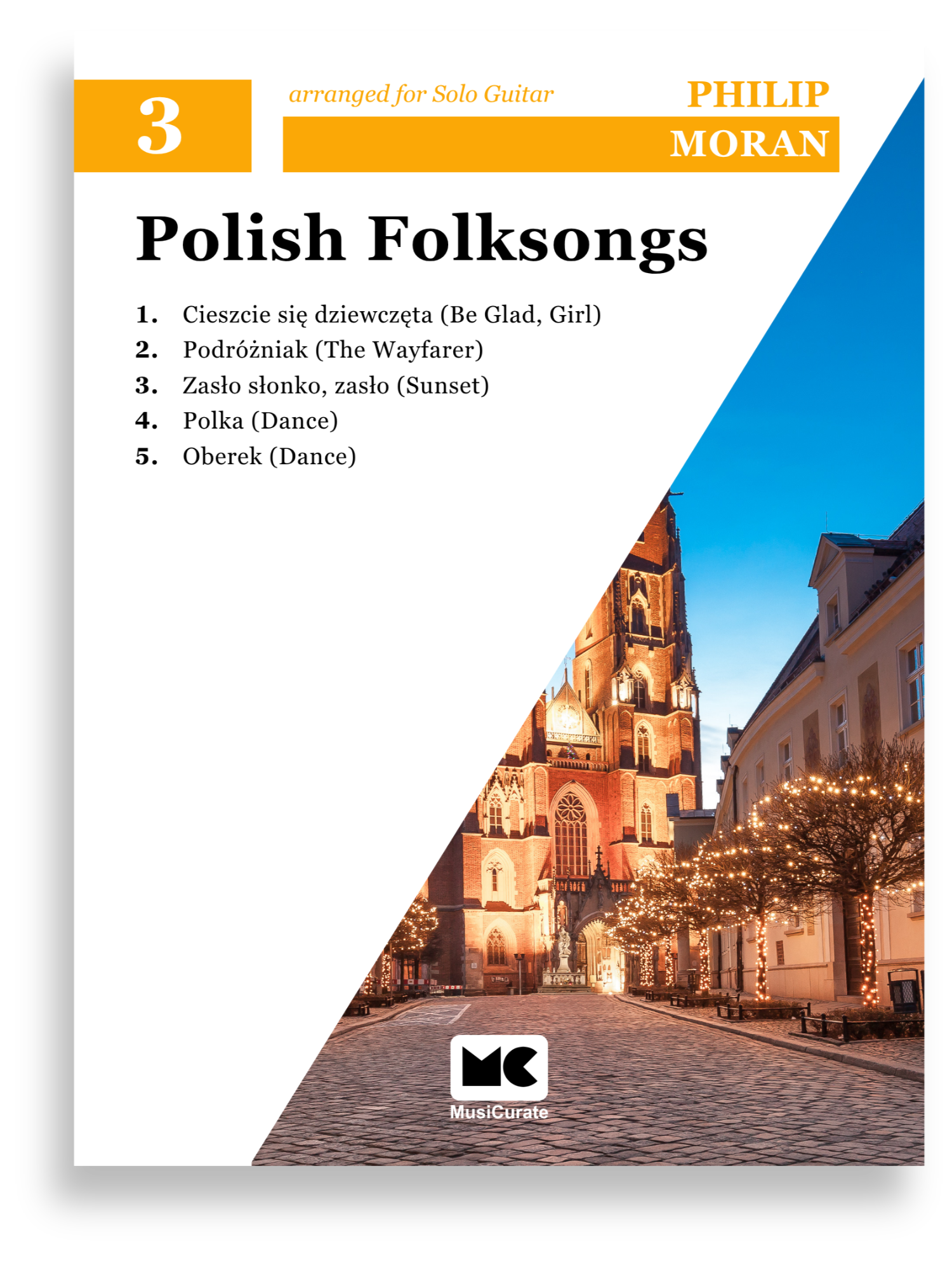Gérer l'anxiété liée à la performance musicale pour les enseignants et les élèves
Partager
par le Dr Daniel Ramjattan
(DMA Université de Toronto, M. Mus, Université d'Ottawa, B. Mus, Université d'Ottawa)
Professeur de guitare, professeur de guitare classique, Université Wilfrid Laurier
Faculté de guitare, Conservatoire royal de musique, École Oscar Peterson
Les professeurs de guitare classique ont désormais accès à des ressources inédites pour aider leurs élèves à améliorer leur aisance technique et leurs capacités expressives d'interprétation. Cependant, leur capacité à aider les élèves à combler l'écart entre la qualité de leurs performances sur scène et en dehors reste incertaine. La littérature clinique décrit ce trouble comme résultant de l'anxiété liée à la performance musicale (APM), une expérience quasi universelle chez les musiciens. L'APM peut souvent conduire les artistes à abandonner leur carrière, à connaître des pannes de performance dévastatrices, et bien plus encore. Les symptômes, bien connus des musiciens professionnels et amateurs, incluent des tremblements des mains, une accélération du rythme cardiaque, des mains froides, et bien d'autres. Si presque tous les musiciens en souffrent à un moment ou à un autre, considérer cela comme une maladie ou un trouble revient à négliger le fait que chacun de ces symptômes peut être pris en charge et géré par une pratique quotidienne. Dans le cadre limité de ce court article, j'espère aider les lecteurs à développer des stratégies pratiques pour aider leurs élèves souffrant d'anxiété liée à la performance musicale, en m'appuyant sur mon expérience et mes recherches.
Dans ma thèse de doctorat intitulée « Anxiété liée à la performance musicale à la guitare classique : stratégies expertes issues de la psychologie et de la pédagogie » (Ramjattan, 2022), j'ai examiné quatorze textes rédigés par des enseignants de guitare classique du supérieur et comparé leurs stratégies pour traiter l'APM à plusieurs traitements évalués par des pairs, issus du domaine de la psychologie et d'autres disciplines connexes. N'ayant trouvé que quatorze textes traitant de ce sujet, malgré une analyse exhaustive couvrant plus de 200 ans de textes, j'ai constaté que les auteurs recommandaient :
- Une préparation adéquate et une maîtrise de tous les défis techniques de chaque pièce de son programme,
- S'enregistrer, simuler des jurys/auditions et se produire fréquemment dans des environnements de plus en plus difficiles en préparation d'un événement majeur
- Choisir un répertoire adapté à sa compréhension technique et musicale
- Réduire les tensions inutiles et utiliser des exercices de respiration
- Visualiser des sections de la musique et les jouer dans son esprit
- Avoir confiance en sa préparation, et
- Maintenir activement une attitude positive envers la pratique et le plaisir de la musique
La littérature en psychologie a largement fait écho à cette approche, les stratégies issues de la thérapie cognitivo-comportementale, de la thérapie d'acceptation et d'engagement et de la psychologie du sport étant les plus largement validées cliniquement. Trois ans plus tard, j'ai constaté que la plupart des stratégies pour aider les individus à gérer l'AMP s'articulent autour du développement de trois concepts fondamentaux au moyen d'exercices pratiques avec les étudiants.
La première, la flexibilité psychologique , consiste à aider les individus à avancer courageusement vers leurs valeurs, même en cas d'épreuve. Puisque la musique est si importante pour nous, elle a aussi le potentiel de libérer nos peurs les plus profondes. Puisque nous avons investi tant de temps et d'efforts dans la musique, chaque performance peut ressembler à une épreuve pour déterminer si notre investissement en valait la peine. Ainsi, notre souffrance, en tant que construction distincte de la douleur, peut être perçue comme des comportements qui nous poussent à fuir ou à éviter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la poursuite de nos valeurs. La flexibilité psychologique nous demande de pratiquer et d'améliorer notre capacité à observer nos pensées, nos sentiments, nos sensations corporelles et nos réactions physiques, et à établir des plans clairs, concrets et quotidiens pour progresser vers nos valeurs. Enfin, elle nous demande d'observer nos pensées et de les séparer de notre identité, même si elles naissent d'un moi en constante évolution. La thérapie d'acceptation et d'engagement (ACT) est un protocole de traitement qui a montré son succès dans des milliers d'études portant sur diverses formes d'anxiété et d'anxiété liée à la performance musicale. Au lieu de viser à réduire les symptômes, elle vise à développer la flexibilité psychologique pour augmenter le bien-être général malgré les difficultés.
Le deuxième concept important concerne l'auto-compassion . Cela signifie essentiellement se traiter avec respect et se parler à soi-même comme un grand professeur parlerait à un élève. Ce concept implique de croire en notre capacité à réussir et en notre bonté intrinsèque, et de croire que nous méritons intrinsèquement d'être aimés, quelle que soit notre production musicale.
Le troisième concept, tout aussi important, concerne la force mentale . On peut l'appréhender en comprenant les quatre C (Perry) :
1) Développer un lieu de contrôle interne, qui implique notre capacité à assumer la responsabilité d’améliorer nos succès et nos échecs sans chercher d’excuses ni nous complaire dans l’autoflagellation.
2) Développer la confiance en notre capacité à réussir, après l'avoir fait par le passé. Cela implique également d'avoir la confiance que, quelles que soient les difficultés, nous avons la force mentale nécessaire pour les surmonter.
3) Viser intentionnellement à relever des défis plus importants dans notre domaine afin de grandir et de dépasser nos limites,
4) Engagement à s'en tenir aux plans que nous avons établis pour nous-mêmes et à rebondir lorsque nous nous en écartons.
Globalement, la souplesse psychologique, l'auto-compassion et la force mentale ne sont pas des états d'esprit fixes que l'on acquiert une fois pour toutes. Comme la guitare, il faut les pratiquer quotidiennement et, comme un muscle, elles se développent lorsqu'on les utilise et se rétractent lorsqu'on les néglige. Heureusement, je crois que la guitare peut devenir un moyen d'améliorer ces compétences et de faire de nous une personne meilleure, plus heureuse et plus épanouie.
Trois façons d'aider les étudiants à se préparer au MPA en cours
#1 : Utiliser les appareils d'enregistrement comme outil principal
L'une des nombreuses façons d'aider les élèves à s'habituer à la scène est de les enregistrer, ou de les faire enregistrer eux-mêmes, en train de jouer leur répertoire. Cet outil peut être utilisé à de multiples fins pour développer simultanément flexibilité psychologique, auto-compassion et force mentale. Cela peut se faire lors d'une phase de pré-écoute et d'écoute.
Juste après l'enregistrement, lors de la phase de pré-écoute, les élèves peuvent noter certaines pensées, émotions et sensations ressenties pendant la performance, tant que le souvenir est encore frais dans leur mémoire. Ont-ils eu des pensées particulièrement fortes ? Si oui, encouragez-les à remarquer que ces pensées, bien que réelles, ne le sont pas forcément. Ce n'est pas parce qu'ils ont pensé « Je suis en train de tout gâcher » que l'enregistrement en témoignera. Avec ces pensées fortes, encouragez-les à écrire les mots « Je pense que… » avant de les écrire. Cela les aide à comprendre que ces pensées naissent d'eux, mais ne sont pas eux.
Avant de poursuivre, demandez à l'élève s'il a ressenti de l'inconfort dans les passages principaux et comment il y a réagi. Si l'inconfort est dû à une tension inutile, l'observer et l'aborder directement dans ce passage musical permettra de résoudre simultanément les problèmes techniques et musicaux et d'atténuer la détresse dans ces passages. Si l'inconfort n'est pas dû à un effort excessif ou à une tension, demandez à l'élève de nommer ces inconforts, par exemple « cœur qui s'emballe », « transpiration », « mains froides », de les noter et de reconnaître qu'ils pourraient réapparaître lors de la prochaine représentation, mais qu'ils ne nuiront pas nécessairement à sa performance s'il s'y prépare. Pour l'aider à se préparer à ces sensations, il peut s'entraîner à exécuter une section de son programme après avoir monté et descendu les escaliers, par exemple, pour s'habituer à jouer avec un rythme cardiaque plus élevé, ou à passer ses mains dans l'eau froide avant de jouer un morceau. Ces éléments indiquent à l'élève que le problème vient de sa réaction, et non des symptômes, et lorsque ces phénomènes se manifestent inévitablement lors des représentations, il ne sera ni surpris ni perturbé.
Ensuite, pendant la phase de lecture, demandez à l'élève d'écouter l'enregistrement, son carnet en main. Demandez-lui d'y consigner des critiques constructives, sans insultes ni compliments superficiels. Demandez-lui d'indiquer au moins deux points positifs de l'interprétation et au moins deux points à améliorer. Il est important que l'élève se parle à lui-même comme un bon professeur. Il ne doit ni complimenter ni insulter le guitariste , mais plutôt complimenter ou critiquer le contenu de l'interprétation avec précision et sans exagération. Par exemple, au lieu de dire « J'ai joué très mal », il peut écrire « Dans la section A, les mesures 5 et 6 comportaient de nombreuses erreurs peu claires ». De même, au lieu de dire « J'ai joué de manière incroyable », il peut écrire « J'ai parfaitement maîtrisé la dynamique et les changements d'accords dans la section B ». Après chaque critique, les élèves doivent se sentir prêts, en collaboration avec le professeur, à trouver des solutions pour améliorer les sections moins réussies.
#2 : Encouragez les élèves à jouer de la guitare avec la confiance qu'ils ont avec une cuillère
De nombreux étudiants souffrant de troubles de l'audition ont tendance à être timides ou peu sûrs d'eux. Ils se décrivent généralement comme manquant d'assurance, ce qui peut souvent affecter leur présence sur scène. Néanmoins, presque tous les étudiants qui ont l'usage de leurs quatre membres font preuve d'une réelle confiance en eux lorsqu'ils tiennent une cuillère. En fait, leur niveau de confiance leur permet de tenir une cuillère sans même la considérer dans leurs mains. Ils peuvent souvent regarder une émission de télévision, ou même se concentrer en lisant un livre tout en tenant une cuillère ! Ce niveau de confiance ne peut émerger que grâce à des efforts persistants et concentrés, à un moment où ils ne peuvent pas s'en souvenir.
De la même manière, l'assurance de jouer naît de la compréhension de chaque passage musical avec la même assurance qu'avec une cuillère, au point de pouvoir chanter en solfège, compter en jouant, et même tenir une conversation simple ou effectuer des calculs élémentaires en jouant un passage qu'on connaît bien. Cependant, développer cette confiance exige une pratique approfondie et délibérée visant à maîtriser chaque détail de la musique, plutôt que de se concentrer sur de larges sections ou de jouer le morceau du début à la fin. Cela exige de l'élève une compréhension approfondie de chaque mesure, et même de chaque temps, de la musique, tant sur le plan technique que musical. En général, cela signifie que jouer une section dix fois de suite sans faute signifie que le risque de commettre une erreur devant d'autres reste minime. À l'inverse, si un élève ne parvient à jouer qu'une partie de la musique avec aisance musicale et technique qu'une fois sur dix, la logique veut que les chances soient minces lorsqu'il joue le passage donné devant un public ! En fait, toutes choses étant égales par ailleurs, ils sont plus susceptibles de jouer légèrement moins bien que dans la salle d’entraînement, s’ils ne s’entraînent que dans un environnement confortable sans que personne d’autre ne les regarde !
#3 : Encourager les élèves à libérer leur tension psychologique
Nombre de ceux qui excellent en musique et s'y consacrent plus sérieusement, que ce soit professionnellement ou en école de musique, vous diront qu'ils ont trouvé leur estime de soi en jouant de la musique pour les autres. La plupart des élèves que j'ai rencontrés en école de musique me confient qu'à l'adolescence, la musique leur a semblé leur donner un capital social. Elle leur a permis d'entrer en contact avec des personnes intéressantes et attirantes, et leur a souvent valu des récompenses, financières ou autres, qui communiquaient implicitement le message que la qualité de leur performance déterminait leur estime personnelle. S'ils jouaient bien, ils devenaient méritants et dignes d'amour, ce qui s'accompagnait souvent d'un accès accru à leurs amis, de relations amoureuses, de l'attention de leurs pairs et de leurs proches, et bien plus encore. Malheureusement, cette identité musicale, lorsqu'elle est menacée par une mauvaise performance, un commentaire négatif d'un professeur, d'un juge ou d'un public, représente un danger important, en particulier pour les jeunes musiciens. Par conséquent, une mauvaise performance les fera littéralement se sentir inutiles ; ils se décriront souvent comme des « mauvais musiciens » ou des « mauvais joueurs ».
Rien n'est plus faux. Nous jouons de la musique, nous la partageons, nous la créons, mais nous ne sommes pas la musique. Elle émerge de nous, comme nos pensées et nos actions, mais elle ne peut être le seul aspect de l'être humain. Séparer la qualité de notre performance de notre identité devient crucial pour les musiciens et ne peut se faire que dans la salle de répétition et pendant les cours. Il est important que le professeur fasse cette distinction pour lui-même et comprenne que distinguer notre identité de la musique que nous faisons ne fera qu'améliorer notre jeu en prévenant les tensions psychologiques. Nous pouvons comprendre ces tensions psychologiques comme les attentes que nous avons pour nous-mêmes et que les autres ont pour nous, et la conviction profonde que la réussite ou l'échec détermine notre valeur en tant qu'individu. Lorsque les élèves réduisent cette tension en se libérant du désir d'impressionner les autres, leur ego cesse de nuire à la qualité de leur jeu et, paradoxalement, ils éprouvent plus d'appréciation, de gratitude et un plaisir sincère à jouer.
Pour faciliter cette séparation, Kenny Werner (1996), dans son livre Effortless Mastery, demande aux enseignants d'interrompre les élèves lorsqu'ils manifestent une frustration ou une colère visibles envers eux-mêmes lorsqu'ils travaillent sur un passage difficile. Arrêtez-les ; encouragez-les à laisser tomber leurs mains et à poser l'instrument en lieu sûr. Demandez-leur d'attendre de sentir le sang circuler dans leurs doigts. Demandez-leur ensuite de dire à voix haute : « Je me libère du désir d'impressionner les autres. » Puis, en s'observant à la troisième personne depuis l'arrière de leur tête, demandez-leur de rejouer le passage. Libérer cette tension psychologique dans la musique rendra celle-ci plus fluide et élégante et communiquera que les élèves sont plus que la musique, et que libérer leur ego, plutôt que de le nourrir, les aidera à atteindre leur plein potentiel.
Références :
Ramjattan, DM (2022). Anxiété liée à la performance musicale à la guitare classique : stratégies d’experts en psychologie et en pédagogie (thèse de doctorat). Université de Toronto. ProQuest Dissertations & Theses Global. 10.13140/RG.2.2.20681.01125.
Werner, K. (1996). Maîtrise sans effort : libérer le maître musicien qui sommeille en nous . Jamey Abersold Jazz.